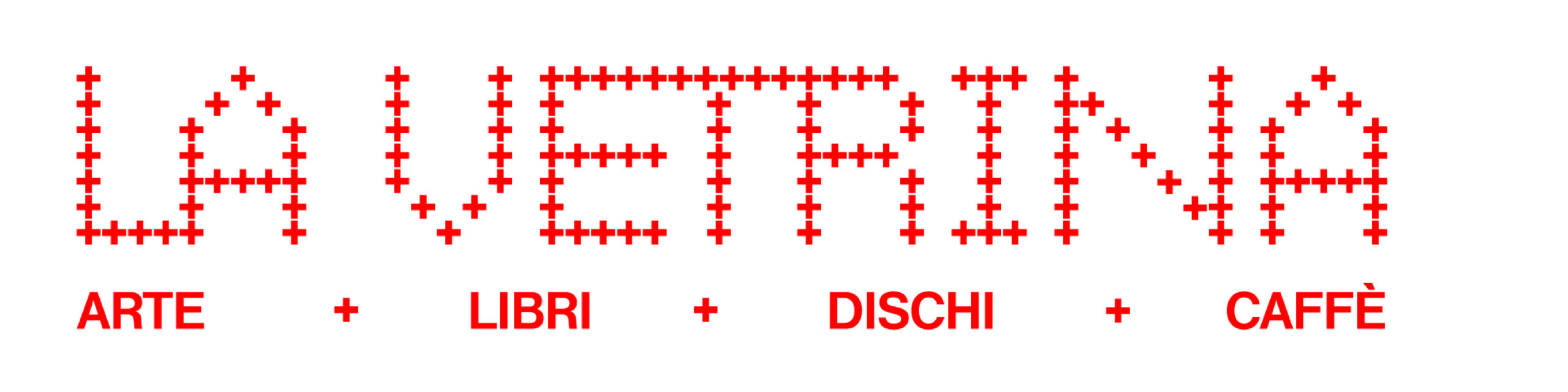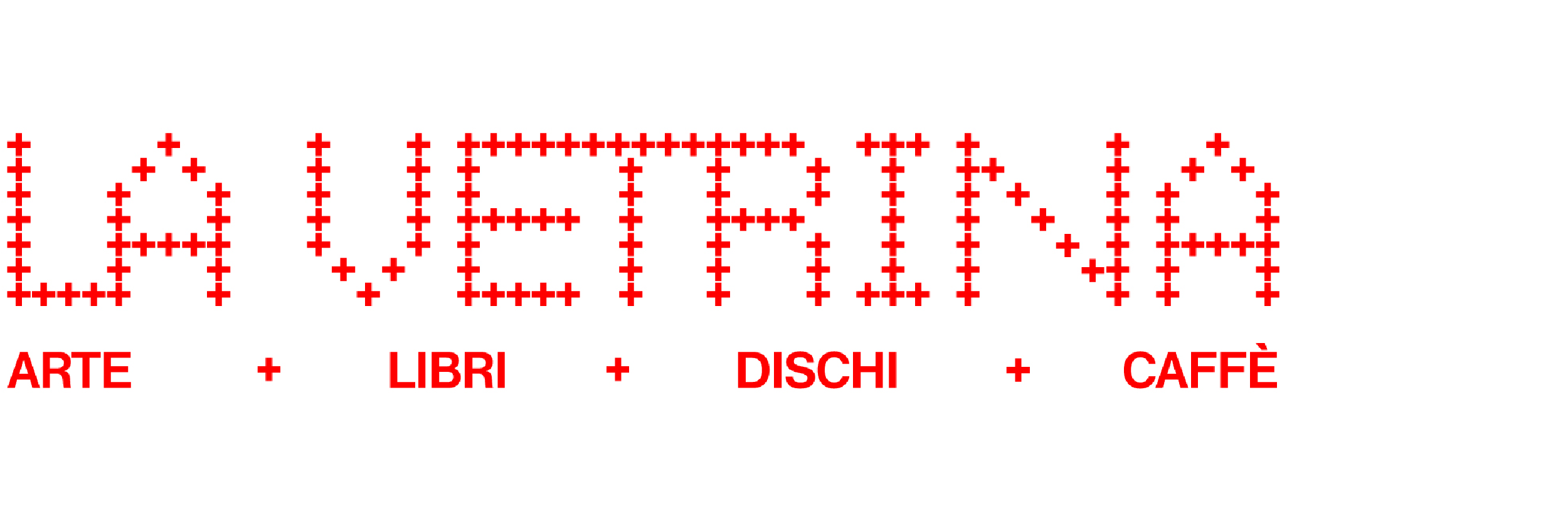1
Le projet 50 Hertz, présenté à la Vetrina à Venise, est une installation sonore qui allie son et céramique. Pour que ça fonctionne, il faut aussi de l’eau et de l’électricité.
Salômé Guillemin, expliquez-nous un peu mieux: la musique, vous l’avez étudiée, avec une formation de violoniste. La céramique, c’est une autre corde à votre arc. Comment vous est venue l’idée de faire réagir ces éléments ?
Durant mes études de violon, j’avais autant de fascination pour le son produit par les cordes à vide que par la quantité de notes que l’instrument permettait d’interpréter. Par la suite, lorsque j’étais en étude d’art et de design, j’ai repris mon instrument pour l’intégrer à une pratique visuelle et sonore plus expérimentale qui préfigurait déjà l’univers sonore de 50 Hertz et plus largement de ma pratique de la musique drone. Mon projet de diplôme s’est constitué dans la continuité de cette recherche au travers d’une installation sonore, que j’ai continué de développer sous la forme d’une performance.
À ce moment là je me suis tournée vers la céramique pour plusieurs raisons : je voulais des formes organiques avec lesquelles interagir et qu’elles soient à l’échelle de mes mains; j’avais besoin des propriétés conductrices et isolantes des terres et des émaux pour pouvoir développer un répertoire de gestes et de contacts autour des céramiques ; enfin et au-delà de l’aspect pratique, la céramique a permis de développer une scénographie spécifique en faisant des choix esthétiques.
Au-delà de la pratique, cette connivence entre son et céramique révèle un dialogue plus profond entre matière et vibration. La terre, élément tellurique, conserve en elle la mémoire du geste et du feu ; elle incarne une matérialité dense, tangible. Le son est immatériel, fugace, insaisissable, mais il possède une puissance vibratoire qui traverse les corps et les espaces. En associant les deux, 50 Hertz fait se rencontrer l’inertie minérale et la fluidité vibratoire, le solide et l’invisible. Avec Flora Basthier, artiste et céramiste sonore, nous sommes d’ailleurs en train de créer un label réunissant des projets qui portent cette réflexion.
2
Vous placez votre installation dans la catégorie « musique drone », pourriez-vous en donner une définition ?
La musique drone est selon moi une pratique fondée sur des sons continus qui évoluent progressivement, de par le volume, leur timbre et leurs additions ou soustractions. Il s’agit plus d’une expérience sensorielle que mélodique. Dans 50 Hertz, les nappes tenues sur la durée font apparaître des harmoniques, des variations de phase, des dissonances et des battements entre fréquences. Ici le drone agit comme une masse sonore qui enveloppe, incitant à l’introspection et à une écoute élargie.
3
Est-ce que vous sentez que votre audience réagit fortement à votre installation 50 Hertz, que vous avez sous-titrée Le chant du spectre ?. Il faut se préparer à frissonner, à trembler, voire plus ?
Les réactions dépendent de la curiosité et de la sensibilité de chacun.e. Parfois, face à l’incompréhension du fonctionnement de ce dispositif, certaines personnes interprètent les sons par le biais de leurs connaissances et de leur imaginaire, ce qui donne lieu à de belles fables. L’installation et la performance ouvrent un espace sensoriel, d’imaginaire et de contemplation : chacun.e y projette ses propres perceptions.
Le titre 50 Hertz fait référence à la fréquence fondamentale du courant alternatif domestique en Europe. Lorsqu’elle est captée par un système de diffusion (enceintes et subwoofer), cette fréquence se manifeste sous la forme d’un bruit résiduel continu, souvent appelé buzz. Le sous-titre Le chant du spectre renvoie au rayonnement électromagnétique produit par les tubes néon qui vient faire « chanter » le buzz : ce champ électromagnétique interfère dans le signal de 50 Hz et entraîne des variations de phase, d’amplitude et de spectre harmonique.
Ces modulations altèrent à la fois le timbre et le volume du buzz, transformant une simple fréquence parasite en matière sonore évolutive. Le titre 50 Hertz, le chant du spectre désigne poétiquement ce phénomène physique et son dispositif, en lui donnant une dimension sensible et imaginaire.
4
Vous soutenez par vos travaux une « écologie acoustique » qui permet une écoute profonde, le deep listening. Quel lien voulez-vous promouvoir entre ces deux termes, écologie et acoustique ?
Pour moi, l’« écologie acoustique » consiste à reconnaître que le son est un milieu que nous partageons, un espace sensible dans lequel nous sommes plongés en permanence. Il s’agit de prendre conscience de cet environnement sonore, d’en percevoir les nuances et d’y déceler ce qui s’ajoute ou s’efface sous l’effet du bruit dominant. Le deep listening, tel que l’a pensé Pauline Oliveros, rejoint cette idée : c’est une pratique d’attention élargie qui nous apprend à écouter autant les sons marginaux que les silences, à accueillir les résonances profondes et à nous rendre disponibles à une perception plus fine. Mais au-delà d’une posture contemplative, j’y vois aussi un potentiel critique. Steve Goodman, dans Guerre sonore, démontre comment les fréquences peuvent devenir des instruments de contrôle ou de mobilisation affective, qu’elles soient utilisées dans le cadre militaire, médiatique ou spectaculaire. Cela signifie que le son n’est pas neutre : il a un pouvoir politique, capable d’agir sur nos corps, nos émotions et nos comportements.
L’écologie acoustique, combinée au deep listening, devient alors un outil: elle permet de prendre conscience de notre immersion vibratoire, d’en percevoir certaines formes d’aliénation sonore, d’ouvrir des possibilités d’émancipation et de la partager collectivement. C’est au travers de ce spectre que je tente, à mon échelle, de maintenir cet équilibre entre la sensibilité poétique du son et la conscience de sa puissance critique.