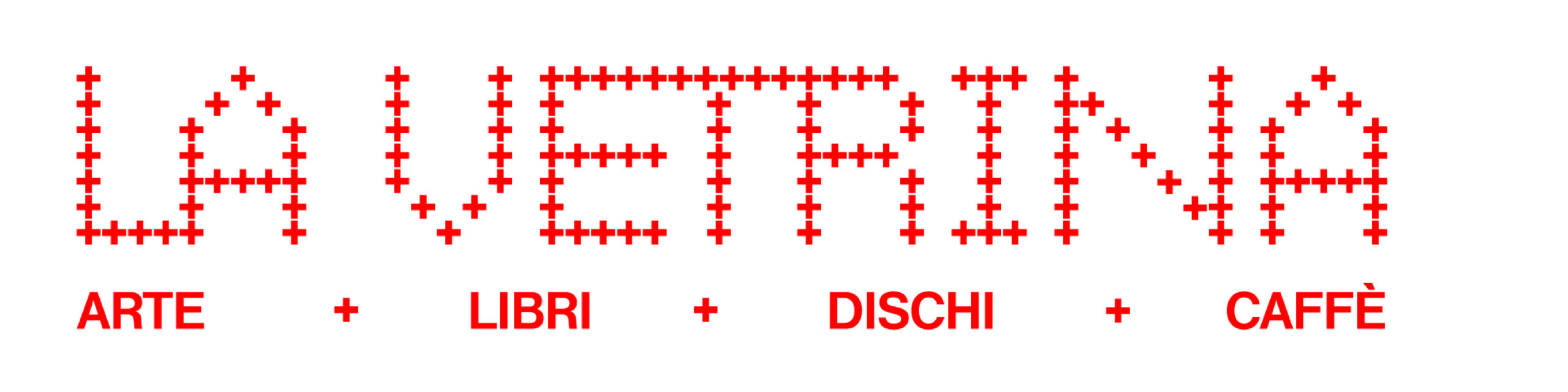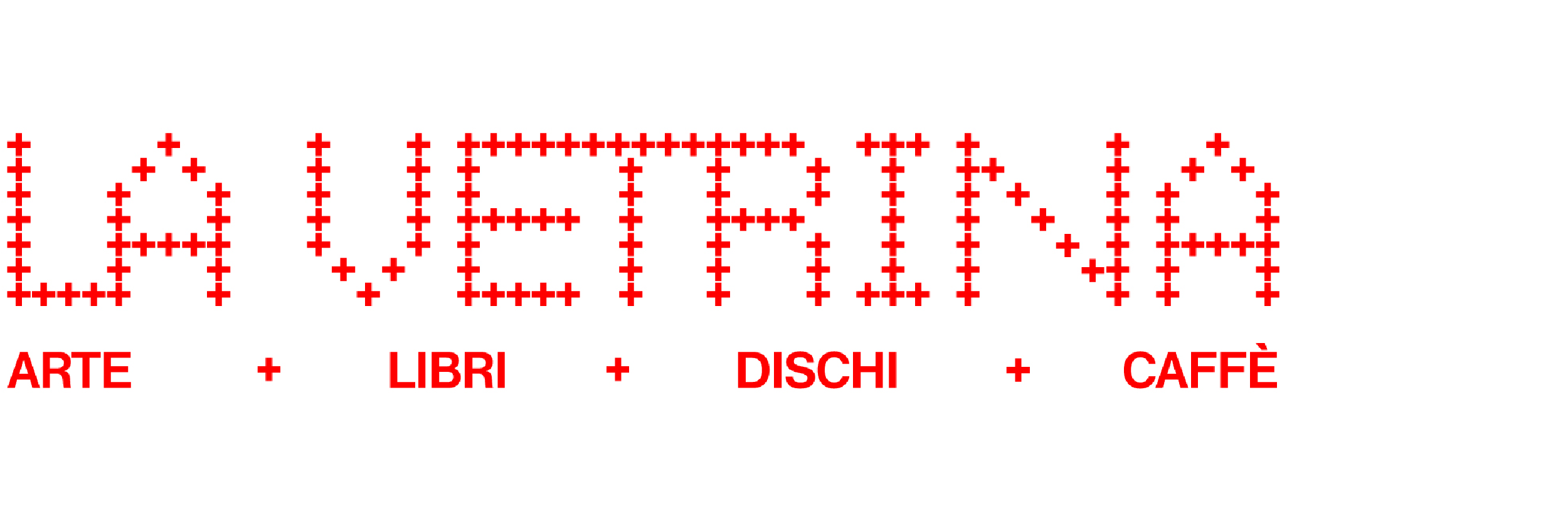1
Le début du livre emmène le lecteur sur vos traces, Alia, au cœur du Sahara algérien. Est-ce que c’est justement parce que vous avez les pieds dans le sable que vous commencez à douter du béton ?
Je commence cette histoire globale par une expérience personnelle.
Lors d’un voyage dans le Sahara algérien, plus précisément dans la palmeraie de Timimoun, un client me sollicite pour concevoir une maison d’hôtes au cœur de l’oasis.
En découvrant le lieu, je suis aussitôt prise d’un certain malaise à l’idée d’y construire. Les chantiers se multiplient, et le parpaing de ciment remplace peu à peu les briques d’adobe, cette terre crue utilisée depuis des siècles dans la région et dans le monde. Il me paraît évident que, dans cet environnement, l’adobe reste un matériau bien plus adapté.
Je prends aussi conscience de mes propres limites : je n’ai jamais été formée à ce matériau. Durant ce séjour, j’en découvre les qualités — sa capacité à être recyclé, à réguler l’humidité et la température intérieure. Il fait étonnamment frais dans une maison en terre.
Je tente alors de trouver un maçon qui saurait encore construire en adobe. Mais les personnes que je rencontre cherchent à m’en dissuader : « La terre, c’est pour les pauvres », me disent-elles. On me propose plutôt du parpaing, présenté comme plus solide, plus moderne.
C’est à ce moment-là que je découvre que ces parpaings sont faits de ciment importé d’Alger, et de sable… également venu de la capitale, à plus de 1 200 kilomètres. Le sable du désert, trop fin, ne convient pas pour le béton.
Je me retrouve face à cette contradiction : construire en béton dans le désert, au nom de la modernité, pour produire des bâtiments qui devront être climatisés… et parfois même chauffés.C’est de cette expérience que sont nés mes premiers doutes.
2
L’architecte que vous êtes est confrontée à l’immense prestige de la construction en béton. Vous y êtes confrontée doublement, en tant qu’étudiante en architecture, puis une fois vos études terminées face à vos clients qu’il faut convaincre qu’il existe d’autres solutions ?
Le béton armé a façonné le XXe siècle. Composé de calcaire, d’argile, de sable, — des matériaux disponibles sur tous les continents —, il se coule dans des coffrages, prend toutes les formes, et associé à l’acier, permet des prouesses structurelles qui ont révolutionné l’architecture. Face à la pierre, plus contraignante dans son extraction et sa mise en œuvre, son succès est compréhensible.
Je ne rejette pas l’héritage du béton ni celui de la modernité, mais nous l’avons sans doute trop aimé : aujourd’hui, 80 % des constructions en sont faites. Pendant mes études, ce matériau allait de soi, présenté comme la seule solution pour donner corps aux espaces libres, très marqué par la pensée corbuséenne des années 20, que nous dessinions. Le béton brut était même un idéal.
Ce n’est qu’après mes études que j’ai commencé à questionner cette domination. J’ai pris conscience de son coût environnemental : l’empreinte carbone massive de la fabrication du ciment, la raréfaction des ressources comme le sable, l’obsolescence du couple béton-acier, et la difficulté à recycler ces structures en fin de vie.
J’ai alors entrepris de me former à d’autres pratiques, d’explorer des alternatives au modèle dominant. En tant qu’architecte, et désormais enseignante, je m’efforce de sensibiliser mes clients comme mes étudiants aux enjeux liés aux matériaux — à leur impact, à la fois environnemental et social, sur les territoires. Face à la force des normes, à l’inertie des habitudes et à l’imaginaire industriel encore très présent, le chemin reste difficile. Mais il est nécessaire, et il ne faut pas le lâcher.
3
La pierre, la paille, le bois, la terre crue… quelle solution à votre préférence ?
Je n’ai pas de préférence en matière de matériaux : chaque réponse est éminemment locale, dépendante de la présence de ressources sur place et des savoir-faire disponibles. On ne peut pas simplement remplacer un matériau par un autre et penser que le problème est réglé.
La globalisation, mais aussi la suprématie de certains matériaux comme le béton, ou encore des produits issus de la pétrochimie — colles, isolants en polystyrène, membranes plastiques — ont profondément modifié notre manière de construire. Nos bâtiments sont aujourd’hui constitués d’une accumulation de couches, de matériaux venus des quatre coins du monde, souvent collés entre eux, rendant toute réparation ou substitution extrêmement difficile.
Face à cela, je défends une architecture plus sobre, une construction simplifiée, attentive à la provenance des matériaux, à leur inscription dans des circuits courts, à leurs modes d’extraction socialement responsable, à leur mise en œuvre. Une construction qui réintègre le temps long, qui permette la réparation, l’adaptation, et surtout le prolongement de la vie des bâtiments.
Au XXe siècle, on a décidé de construire pour 50 ans. C’est évidemment trop court. Les villes, historiquement, se sont toujours construites sur les traces, les ruines, les structures des précédentes — sans passer par la case « décharge ».
4
Le béton n’échappe pas au marketing écologique trompeur… vous abordez dans votre livre le « béton vert ». C’est du pur greenwashing ?
Ce n’est pas exactement le cas. De nombreuses recherches, sont menées par des laboratoires universitaires et par certains départements R&D des grands groupes cimentiers, visent à réduire l’empreinte carbone du béton. L’exemple le plus probant à mon sens est le développement du ciment LC3 (Limestone Calcined Clay Cement) par l’École polytechnique fédérale de Lausanne qui offre des perspectives prometteuses, avec une réduction potentielle des émissions de CO₂ allant jusqu’à 40 % . Cependant, certaines initiatives, comme la gamme ECOPact de Holcim, bien que revendiquant une diminution significative de l’empreinte carbone, suscitent des interrogations. Il est essentiel d’examiner attentivement ces allégations pour distinguer les avancées réelles des stratégies de greenwashing.
En effet, des critiques ont été émises concernant la transparence et l’efficacité réelle de certaines de ces solutions dites « vertes ». Par exemple, des organisations environnementales (Carbon Disclosure Project) ont attribué à Holcim une note de « D » pour sa performance en matière de durabilité, pointant du doigt un manque d’investissements suffisants pour réduire les émissions directes de ses usines dans le monde. De plus, l’utilisation de laitiers de haut fourneau, un coproduit de la sidérurgie affichant un bilan carbone très bas en raison d’une décision comptable européenne, soulève des questions. Certaines entreprises importent également du clinker (composant principal du ciment) depuis des pays hors de l’Union européenne, où le bilan carbone n’est pas établi, afin de présenter leur ciment comme « bas carbone » en évitant les contraintes réglementaires européennes. Actuellement, le secteur du béton vert est comparable au « Far West » : il règne une grande confusion, même parmi les professionnels du BTP (Bâtiment Travaux Publics). Cette situation rappelle celle de l’hydrogène pour l’aviation, où l’on espère que des bétons zéro carbone permettront de poursuivre les activités sans modifier les pratiques, les processus ou les filières cimentières qui alimentent les chantiers.